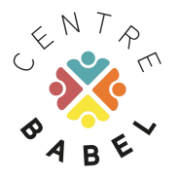Il y a quelques mois, est sorti au cinéma Memory Box, de Joana Hajithomas et Khalil Joreige. Dans ce film, nous rencontrons trois générations de femmes libanaises émigrées à Montréal qui s’apprêtent à fêter noël : Téta, la grand-mère, Maia, la mère, Alex, la fille. Soudain, on sonne à la porte, un colis en provenance du Liban vient d’être livré. Immédiatement remisé au sous-sol, son poids dépasse ce que les étagères peuvent supporter, il tombe en un vacarme qui résonne dans toute la maison. Son contenu est répandu sur le sol : des photographies, des cassettes audio et des carnets datant des années 80, les années de la guerre. Alex questionne sa mère, qui ne veut rien dire de ces images éparses, de ces souvenirs réduits au silence. L’adolescente n’a pas dit son dernier mot. Elle se lève au milieu de la nuit, interroge et s’approprie les images, en les photographiant sur son téléphone. Sur un vieux poste radio, elle écoute les cassettes, entend sa mère raconter ses amours et la guerre, les fêtes et les bombardements, les baisers au cinéma et les checkpoints militaires. Alex imagine l’histoire de sa mère, mais cette histoire ne lui est pas adressée, elle est discontinue et inquiétante, ce que le film figure par des photogrammes brûlés et des séquences saccadées. Quelques jours plus tard, Maia accepte de se raconter. Elle partage un récit qui n’est plus caché dans les interstices des images, mais offert dans les mots qu’elle prononce en enlaçant sa fille. Le film peut alors nous plonger dans des flash-backs narratifs et non plus sensitifs. Le sens n’émerge pas parce que la boîte est ouverte, mais grâce à une peau vocale et filiale qui enveloppe les mots.
Dans la boîte, il y a aussi un appareil photo, contenant une pellicule qui attend d’être développée depuis presque quarante ans. Lorsque Maia se décide à obtenir les tirages, on la prévient qu’ils sont sûrement voilés, aucun boîtier photographique n’est hermétique à la lumière aussi longtemps. Elle récupère les clichés, des dizaines de photographies de son père décédé, prises compulsivement pendant les funérailles. Le temps a brûlé la dépouille, effacé les traits du visage de ce père tué par la guerre. Les images sont presque entièrement blanches désormais. Une dernière photographie, celle des rives libanaises, prise alors que Maia quitte le pays par bateau. La photographie demeure très sombre, malgré la surexposition. On devine que si elle avait été développée des années plus tôt, l’image aurait été entièrement noire. Impossible de voir le pays que l’on quitte à cause de la guerre ? Impossible de figurer le trauma que l’on est en train de vivre ? Si Maia peut enfin voir les rives du Liban, qui succèdent à l’ombre du père défunt, c’est parce qu’elle peut les décrire à sa fille. Ainsi dans leur film bouleversant, Joana Hajithomas et Khalil Joreige nous enseignent comment dire l’intimité de l’Histoire collective de la guerre, comment voir ce que les photographies sans légende cachent dans les caves, comment montrer ce que les familles taisent et par-là transmettent en secret, comment entendre la jeunesse des parents pour devenir soi-même adulte.
Guillaume