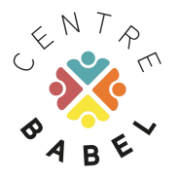La perte

En tant qu’éducatrice spécialisée, je suis témoin et confidente des pertes vécues par les jeunes « mineurs ou majeurs non accompagnés » que j’accompagne. Un départ, un parcours, une traversée, une arrivée : ces expériences sont vectrices d’un point commun pour ces jeunes, la perte. Elle débute lors du départ du pays d’origine : perte de repères et de racines, mais aussi perte d’êtres chers. Il faut beaucoup d’espoir, de force et de courage pour continuer à croire en soi, en ses valeurs et ce que l’on est, quand tout ce qui est demandé par le pays d’accueil est de s’adapter à de nouvelles représentations, de mettre de côté la langue maternelle et de « perdre » des façons d’agir, de manger, de s’habiller, de penser. Il est coûteux et complexe de surmonter ces pertes. Le rêve et l’espoir permettent de les mettre à distance, pour un temps, mais est-ce suffisant ? Moussa rêve de devenir footballeur, Mohamed chauffeur poids lourd comme son père, Demba médecin pour soigner les siens. Ils avancent ainsi, grâce à un rêve d’avenir. S’agit-il pour autant de ne pas se retourner, d’oublier ce qui a été vécu ? Être constamment actif et en mouvement, afin ne pas laisser place au vide et aux pensées envahissantes, n’est pas tenable indéfiniment. Souleymane se confie peu, mais ne s’arrête jamais. Ses semaines sont surchargées d’activités, ainsi peut-être que de toutes les choses qu’il n’évoque pas, sont perdues tout en étant très présentes en lui.
Une autre perte à évoquer est celle de l’innocence au cours du long périple migratoire. Il m’est difficile d’entendre à quel point Cheick a perdu une part de lui-même pendant le voyage. Il a mûri d’un seul coup, et agit désormais comme un adulte, ayant à sa charge des responsabilités qui n’incombent pas habituellement aux adolescents de 14 ans. J’ai l’impression que son enfance lui a été volée.
Il me faut également mentionner la perte des sens, des odeurs, des saveurs, des textures, du bain sensoriel caractérisant une culture. Abdul comble parfois cette perte en confectionnant les plats que sa grand-mère avait l’habitude de lui cuisiner, mais il constate, résigné, que « ce n’est pas pareil, ils ont perdu de leur saveur ici ». La perte, c’est aussi celle de la langue maternelle. Parfois réduite à quelques mots en partie oubliés, elle risque de devenir synonyme d’angoisse. Mamadou a peur de ne plus comprendre ses proches, de retourner un jour au pays et d’y être perçu comme un étranger. Il essaie d’entretenir sa langue natale, le bambara, avec sa mère au téléphone, ainsi qu’avec les jeunes accueillis sur le service, ses amis. Mais là encore, « ce n’est pas pareil », constate-t-il.
Je pense également à la perte des objets : l’acte de naissance de Demba, le t-shirt préféré de Saidou, la photo de la sœur de Mahamadou, le bracelet d’Oury… Ces objets ont voyagé en terre et en mer, pliés, cachés, abîmés ou emballés soigneusement dans plusieurs couches de plastique. Ils ne survivent pas toujours au parcours migratoire. Ces précieux objets, parfois de véritables morceaux de soi et de la famille, peuvent devenir sacrés en incarnant un ancrage salutaire. Oury est alors profondément blessé d’avoir eu « donner » son bracelet à un passeur et d’avoir vu son acte de naissance « retiré » par l’administration française.
La perte, les innombrables pertes, viennent dire la douleur, la colère, la tristesse, la résignation. Comment répondre à ces pertes et à l’angoisse qu’elles rendent palpable et expriment ? Comment être là pour ces jeunes et éviter qu’ils ne se perdent eux-mêmes à leur tour ?
Mélissa