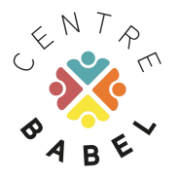Le rôle des co-mères

Il faut tout un village pour élever un enfant
Proverbe africain
C’est en arrivant dans le centre d’hébergement et de stabilisation dans lequel je travaille que je me suis interrogée sur les différentes conduites de maternage. Est-ce que le lien entre une mère et son enfant est le même partout dans le monde ? Qu’est-ce qui est différent ? Est-ce que ça dépend de la culture de la maman ou de son histoire familiale ?
Une rencontre m’a particulièrement interpellée à ce sujet. Betty est malinkée, elle est originaire du Libéria. En dépit des difficultés économiques rencontrées, elle s’est toujours sentie très entourée. Elle parle avec émotion de la grande maison dans laquelle elle habitait avec toute sa famille, cousins, oncles et tantes compris. Ils se côtoyaient tous chaque jour.
Dans le même temps, j’apprends à quel point, ailleurs, dans les pays d’Afrique Subsaharienne par exemple, les enfants appartiennent au groupe et sont considérés comme une richesse voire une chance. Chacun des membres de la famille est là pour eux. J’entends donc l’importance de la communauté toute entière pour accueillir un enfant.
Je pense alors à nos habitudes en France, à la place centrale qu’ont les parents, et eux seuls, pour penser l’enfant. Les femmes migrantes que nous accueillons ont parfois vécu à travers un autre modèle. Je me questionne sur ce que cela peut créer en elles lorsqu’on leur propose d’accueillir et penser leurs enfants d’une manière si différente, si “unique” et individualisée… sans groupe finalement.
Betty est arrivée en France seule et a accouché de son deuxième enfant il y a six ans. Elle explique avoir vécu un grand moment de solitude à cette époque. Ce n’est que lors de son arrivée dans le centre d’hébergement qu’elle a enfin pu se poser. Alors qu’on lui a présenté le studio comme étant petit, elle, sourit et nous précise que ce n’est pas petit du tout, ce qui lui importe est d’avoir un toit sur la tête, pour elle et son nouveau-né. Betty me raconte que dans la salle de jeux, elle s’est rapprochée d’une autre maman, parlant la même langue qu’elle. Elles vivaient à ce moment-là, les mêmes épreuves avec leurs enfants, partageant cette même solitude.
Marie Rose Moro souligne souvent la place fondamentale des co-mères pour ces mamans, éloignées de leur pays, de leur famille, dans un des moments les plus vulnérables, celui d’accueillir un enfant. En effet, j’observe dans mon quotidien professionnel, à quel point ces mamans venues d’ailleurs sont rassurées des liens tissés entre elles : elles se relaient pour emmener les enfants à l’école, aller les chercher, aller chez les unes, chez les autres. Elles font famille et les enfants apprennent vite à utiliser la dénomination de « tata » en s’adressant aux autres mères, à leurs co-mères. Je me dis que, finalement, cette communauté permet de porter les enfants, mais aussi, surtout, les mères elles-mêmes.
Betty tient cependant à me préciser qu’elle ne peut pas se confier à tout le monde, que si elle se livre trop à quelqu’un qui lui voudrait du mal, cela peut être dangereux. La confiance se gagne doucement mais sûrement, même dans cette nouvelle famille choisie dans la solitude de la migration.
Betty me le répète souvent : “nous avons cela en commun, ce qui compte, c’est les enfants”.
Laure