Ibejis
19h47, terrasse ensoleillée d’un bar. Les gens se pressent et se dépassent les uns les autres le long de l’avenue. Dans la cohue, je finis par voir apparaître la silhouette d’Emma. « Tu m’attends depuis longtemps ? Quelle galère le métro aujourd’hui ! ». Emma, je la connais depuis longtemps. Je doute que les aléas des transports en commun suffisent à lui dessiner cette mine fermée. Avec plus ou moins de subtilité, je mène mon enquête pour savoir ce qui pourrait bien la contrarier. Rapidement, elle me parle de sa mère. Cette dernière a eu Emma très jeune et il n’est pas rare qu’on les prenne pour des sœurs, voire même des jumelles. Emma m’a souvent dit à quel point sa mère et elle étaient proches. Ce qui pouvait sécuriser Emma quand elle était enfant, a aujourd’hui tendance à l’inquiéter « c’est comme si la vie de ma mère ne tournait qu’autour de moi, tu trouves pas ça flippant toi ? ».
Toute sa vie, la mère d’Emma aurait cherché à combler un manque viscéral. Elle avait cherché partout les raisons de ce vide jusqu’au jour où, au détour d’une conversation lors d’un repas de famille, la lumière avait été brutalement projetée sur cette ombre de toujours. La mère d’Emma avait partagé le ventre de sa propre mère avec une jumelle, sa jumelle. Cela pouvait-il expliquer ce lourd sentiment d’absence qui l’avait accompagnée toute sa vie ?
En écoutant mon amie, je repensais aux statuettes nigérianes, portées par les mères lorsqu’un·e de leurs jumeaux·elles décèdent. Au Nigéria, au sein du peuple Yoruba, les jumeaux sont nommés ibejis, ce qui signifie « nés deux ». On considère que les ibejis partagent une même âme. Ils sont dits « enfants du tonnerre », esprits puissants et protégés par Shango, dieu du fer et de la foudre. Leur venue est une bénédiction pour la famille. Lorsqu’un des jumeaux décède à un âge précoce, la famille consulte un babalawo, prêtre du culte d’Ifa, qui les oriente ensuite vers un sculpteur. Celui-ci confectionne l’ere ibeji, ere signifiant « image sacrée ». Après avoir reçu la statuette des mains du sculpteur, « la mère doit retourner chez elle […] sans regarder derrière elle, sous peine de subir un grand malheur. L’âme du jumeau défunt ne sera que provisoirement installée dans la statuette de bois dans l’attente d’un retour sur terre par le biais du corps d’un nouveau né ». En portant ce symbole de l’enfant perdu, la mère, la famille, mais aussi l’autre enfant donnent forme à son absence. Ils attribuent une place à ce qui a été perdu pour mieux le penser.
Comme pour la mère d’Emma qui a passé sa vie à chercher de comprendre cette absence qu’elle ne pouvait que pressentir, nombreuses sont les histoires de familles où le non-dit d’une perte hante le survivant à son insu. Je me disais en moi-même : la parole, peut-être, aurait pu servir de contenant et aider la mère d’Emma à rendre son manque plus figurable. Mais il se peut aussi que parfois, la peine soit trop lourde pour être racontée…
Comment pourrions-nous alors, à la manière des Yorubas ou d’autres, trouver un moyen de façonner un support à nos deuils, support qui nous servirait tant à survivre qu’à mettre en récit ce qui serait sinon impossible à dire ?
En nous prévenant de comparer ou de hiérarchiser les façons de penser et de faire, comment chacun d’entre nous pourrait-il au contraire trouver dans l’altérité les ressources créatives pour questionner, enrichir et remettre en mouvement ses propres pratiques, métisser sa manière d’appréhender le monde ?
Eléonore

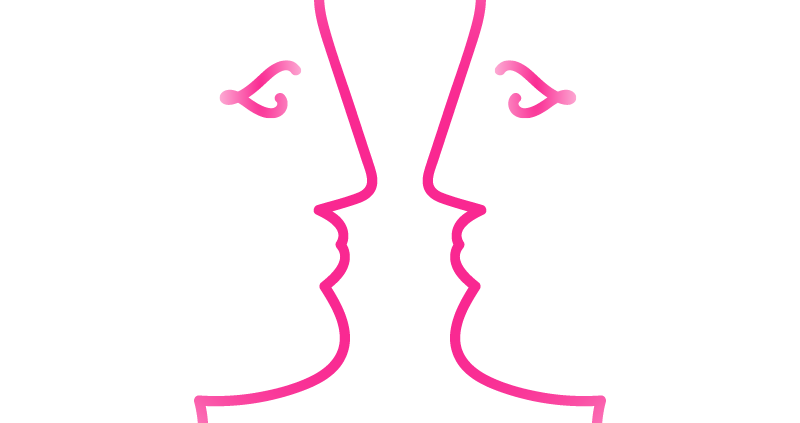








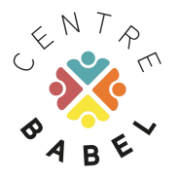





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !