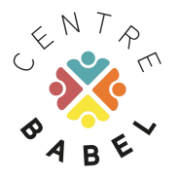D’ici mais née ailleurs

Je suis récemment tombée sur le témoignage d’une jeune femme née au Niger, adoptée à l’âge de trois mois par une famille française habitant en Normandie.
Dans le cadre des adoptions internationales, longtemps a prévalu le “mythe de la page blanche” : les parents adoptifs donnaient un prénom français aux enfants afin de leur permettre de repartir sur “une nouvelle base”. L’adoption était conçue comme une seconde naissance. L’objectif était d’assimiler cet enfant venu d’ailleurs, qui souvent avait une apparence physique différente de celle de ses parents adoptifs.
Cette femme, dont le témoignage m’a bouleversée, exprimait sa difficulté à se construire en tant que femme noire dans une famille blanche, malgré l’amour et la grande bienveillance de sa famille adoptive. Comment développer son identité quand on ne ressemble pas aux membres de sa famille, quand on représente l’altérité dans ce qui incarne d’ordinaire le semblable ?
Elle qualifie ses parents de « colorblind » et s’est toujours sentie comme un membre de la famille à part entière. Où est le problème, pourrait-on se demander ? Quand on prend le temps de réfléchir, le terme « colorblind » évoque l’idée de ne pas voir les différences de couleur de peau, mais est-ce bien réaliste ? Pourquoi vouloir ignorer ces différences ?
Un exemple concret met en lumière les limites de ce positionnement : comment acquérir des techniques de soin de sa peau et de ses cheveux lorsque sa mère ne les partage pas et ne peut pas nous les transmettre ?
Étant la seule enfant noire dans son village normand, elle a vécu une succession de micro-agressions racistes que ses parents minimisaient, pensant ainsi la rassurer. Un tel comportement a suscité beaucoup de colère à leur encontre.
Ces brimades l’ont amenée à avoir honte d’être associée à l’Afrique, une affiliation qui lui apparaissait comme dévalorisante. Elle évoque également la haine et le rejet qu’elle a pu ressentir vis-à-vis d’elle-même, notamment lorsqu’elle voyait son reflet dans le miroir, un reflet qui la ramenait malgré elle à son africanité, alors qu’elle se rêvait blanche comme tous les membres de sa famille.
Une fois adulte, elle a fait face aux discriminations et au racisme lorsqu’elle a cherché un travail et un appartement, elle qui avait pourtant tous les codes de la culture française et qui se sentait au niveau maximum de l’assimilation.
Désormais sortie de son milieu familial, elle rencontre d’autres personnes noires et se met en quête de son africanité. Selon Françoise Sironi, la construction identitaire chez les métis culturels est un processus qui passe par trois phases : d’abord, l’identification à la culture la plus valorisée et valorisante, puis, inversement, à l’autre culture, et enfin, dans le meilleur des cas, se construit une unicité dans la multiplicité, c’est-à-dire une multiplicité rassemblée.
Chez les enfants métissés, les multiples sources d’identifications, les différentes loyautés et appartenances peuvent être source de souffrances mais aussi de grandes richesses, comme l’évoque Marie Rose Moro dans son livre Enfants d’ici venus d’ailleurs.
Ainsi, pour ne pas sombrer, elle crée. La musique et l’écriture la sauvent… Elle livre à travers ses chansons une part de son histoire et de son unicité-multiplicité retrouvée… Elle s’appelle Rakia, je vous invite à écouter sa musique.
Anissa