Le corps pour passeport
Depuis toujours, j’ai cet attachement particulier pour les objets chargés d’histoire, ou plutôt pour les histoires qui restent comme pudiquement engrammées au travers des objets. Ce n’est pas le caillou que je garde presque religieusement sur ma table de chevet, mais la matérialisation d’un souvenir qui m’est cher et dont moi seule connais le décryptage. Ce ne sont pas les objets réels mais les objets comme écrins de sens, supports de symbole, de représentation, voire d’imaginaire. Ce sont eux que je dispose autour de moi, à la manière du Petit Poucet, comme pour m’assurer de pouvoir toujours faire cet aller-retour entre mon passé et mon présent.
Il y a quelques années, alors que j’arpentais les allées d’une brocante à la recherche de nouveaux trésors d’histoire et de sens, mon regard a été capté par un petit stand de masques d’Afrique Centrale, dont certains pouvaient presque tenir dans une poche. Le vendeur, ou devrais-je dire le conteur, m’en expliqua les fonctions. Aussi appelés masques-passeports, ils permettaient notamment au Cameroun, au Gabon et au Congo, avant l’arrivée des Européens, de se déplacer plus aisément d’un territoire à un autre. Mais ils servaient surtout, par un système de formes et de couleurs déchiffrable par les initiés, à traduire l’inscription communautaire, la position sociale et l’appartenance à un corps de métier. Ils matérialisaient et donnaient à voir en un coup d’œil une représentation condensée de l’identité et de l’histoire du porteur, qui ne saurait être autrement directement manifeste.
Cette nécessité d’attester de ses origines et de son vécu demeure une question centrale dans notre société. Quelles preuves, quelles marques sont aujourd’hui valables aux yeux des juges qui donnent ou non le droit du sol à celles et ceux qui cherchent asile ?
Lorsqu’un demandeur d’asile arrive en France, pour obtenir le statut de réfugié, il lui faut se soumettre à l’examen de la preuve. Comme si les examens psychologiques ne suffisaient pas à mettre en exergue ou à quantifier la souffrance de façon assez précise, il faut certifier, authentifier, devant des administrations toujours plus avides de preuves, si possible mesurables, graduables et classables. Mais comment faire lorsque les preuves matérielles, les passeports et autres objets témoins de l’histoire, font défaut ? C’est alors qu’apparaît le principe de preuve par le corps et avec lui une inversion de logique puisque les plus maltraités deviennent les plus chanceux, grands favoris d’un interminable marathon. Le corps résistant, qui a tenu bon jusqu’au pays d’accueil, est désormais un corps de trahison, qui intériorise et refuse de se faire le porte-parole de la souffrance.
Le corps est ainsi à son tour examiné, séparément du reste, comme s’il pouvait raconter une histoire différente de celle déjà relatée. On analyse, on cote, mais surtout on décompose, on clive. Les administrations imposent un nouveau diktat, introduisent de nouvelles normes et auditionnent pour le corps le plus visiblement blessé, meurtri, torturé.
Pour accéder à de meilleures conditions, certains demandeurs d’asile vont jusqu’à s’automutiler. Puisque la souffrance est en vogue, il faut la donner à voir. Tapie dans un lieu mal défini et invisible, la souffrance psychique se rend alors visible aux yeux de tous, elle se matérialise, prend corps. Elle peut enfin être reconnue par les administrations qui miment de ne croire que ce qu’elles voient. Plutôt que de réduire le corps à un objet, surface de preuve déshumanisée, ne pourrait-on pas imaginer que la parole puisse être un objet suffisamment ancrée dans la mémoire pour attester de ce qui est advenu ?
Éléonore










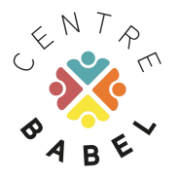





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !